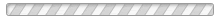En 1979, Edmond se livrait dans l’ouvrage « L’âme corse » de Louis Panassié et Laurent Verdeaux. Il parlait entre autre du clan, omniprésent et puissant dans son enfance, et qu’il a vu évoluer. « Mes compatriotes sont très souvent démissionnaires, veules, ils ont des attitudes de bravaches, alors que le courage le plus simple est un courage assumé sans violence » disait-il. L’évolution de cette organisation de la société corse due à l’histoire (histoire corse ou simplement humaine, pourrait-on dire), ne lui plaisait pas toujours, il savait qu’elle ne pouvait épargner personne et qu’il fallait savoir la dompter. C’est probablement ce qui explique son acharnement tout au long de sa vie à toujours mettre en avant les valeurs de démocratie, de transparence, de probité. Car en oublier le respect, c’est forcément retomber dans les erreurs des générations précédentes… Ce serait une faute très lourde que d’oublier ce message.
«Je crois que nos compatriotes nous ont compris, qu’ils savent ce que nous voulons, mais qu’au fond d’eux-mêmes ils se disent « d’un côté la facilité et la perte de ce qui était notre raison d’être, notre nationalité, notre culture. De l’autre, l’effort, le sacrifice, la solidarité retissée, l’abandon de toutes les valeurs marchandes du XXe siècle ». Moi j’ai une certitude : l’enjeu est tellement important, que s’il faut tout y perdre – la vie, la liberté – s’il faut trimer, on doit quand même le tenter, parce que c’est pratiquement sans appel, parce que cette communauté ne reviendra plus : à cause de l’invasion des médias, de la diffusion de concepts qui ne sont pas les nôtres. Le transistor, le match du Sporting, c’est l’introduction dans notre mentalité rurale – un petit peu rétrograde – d’appétits qui n’étaient pas forcément les nôtres…
Je crois que le piège le plus terrible est de chercher à tout prix des excuses au peuple corse. C’est trop facile…
J’ai grandi dans les messes chantées dans les enterrements. J’ai grandi dans les voceri, dans les lamenti, dans les pleurs. L’agonie de quelqu’un au village – mais c’était quelque chose ! Tout le village devenait pudique, silencieux. Tout simplement parce qu’il y a devant la mort une attitude profonde de respect, d’inquiétude, d’angoisse, de compassion partagée. Nous autres les enfants jouions assez loin du village, qui allions braconner, pêcher à la main, quand il y avait l’angélus à cinq heures, c’était le signe de l’approche du soir, du retour à la maison, c’était le rythme de notre vie. Et puis tous ces gestes quotidiens : les bergers qui allaient couper les branches fraîches pour les chèvres, l’abattage des bêtes et le signe et l’ochju… C’était une communauté profonde, intrinsèque et c’est là-dedans que le clan, dans ce qu’il a de généreux, de fraternel, a puisé sa force. Autrement ce serait la maffia ! Mais le clan est quelque chose d’enraciné, de profond parce que nous en faisons tous partie. Parce que nous en venons tous. Parce que nous lui avons donné force, vie, crédibilité. Le clan, ce n’est pas quelque chose d’artificiel. Et les Rocca Serra et les Giacobbi sont aussi Corses que nous…
Où se produit le schisme, c’est que, au-delà de cette communauté de protection, de solidarité qui étendait ses racines sur le Continent (surtout lorsque les Corses s’expatriaient, que ça devenait encore plus efficace, fraternel, parce que déraciné), au moment où la Corse a commencé à se développer, ce clanisme est devenu répulsif. Il s’est mué en frein à l’expression d’une identité. Il est devenu la répartition d’avantages, de prébendes, de combinaisons à tous les échelons, non pas pour émanciper les gens mais pour les aliéner. » •