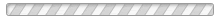René Fregni est un écrivain originaire de Corse ayant vécu à Marseille. Après une adolescence d’errance en rupture scolaire, il choisit de déserter le service militaire, ce qui conduira le jeune homme qu’il était de la rue à la prison. Dans sa cellule, il découvre la littérature et l’écriture, qui deviendront une partie intégrante de sa vie. De la vie carcérale à la vie d’écrivain, il retrace avec nous ces épisodes de sa vie, qui le reconduisent incessamment à ses origines.
Dans « Déserter : entretiens avec Fabrice Lardreau », vous retracez différents épisodes de votre vie, dont la prison, où vous avez découvert la passion de l’écriture. Parlez-nous de cette période.
J’ai commencé par déserter l’école parce que les enfants s’étaient moqués de moi à l’âge de 7-8 ans, car je portais des lunettes très épaisses. Je traînais dans les rues, dans les collines à Marseille, je ne voyais pas les caractères d’imprimerie donc j’ai pris peur de l’école. Je ne voulais pas qu’on se moque de moi et je suis parti traîner dans les rues. J’ai raté toute ma scolarité. J’étais parti sur les routes et je suis arrivé en retard au service militaire à Verdun. Pour deux mois de retard, j’ai écopé de six mois de prison militaire. Je me suis retrouvé avec un autre Corse qui avait fait un braquage à 17 ans, qu’on avait placé en prison militaire en raison de son âge deux ans plus tôt. C’est lui qui m’a parlé de tous ces livres qu’il lisait depuis son incarcération, alors que moi je n’avais jamais rien lu. Comme moi, il était un vagabond, jusqu’à ce qu’il découvre la lecture. C’est de plus en plus fréquent, les prisonniers que j’ai rencontrés plus tard se sont mis à lire en prison.
Vous avez vous-même animé des ateliers d’écriture en prison.
Après la publication de mon premier roman en 1988, le ministère de la Culture m’a appelé. Comme j’y racontais mes 6 mois d’emprisonnement et que j’étais publié, ils m’ont proposé l’animation d’atelier d’écritures. On m’a envoyé dans la vieille prison d’Avignon où j’ai improvisé mes ateliers d’écriture avec 12 détenus pendant trois ans. Depuis 30 ans, je vais dans toutes les prisons, en parallèle de mon métier d’écrivain.
Considérez-vous que la littérature a été une deuxième libération ?
En prison à l’époque, la littérature était la seule échappatoire. Pas de télévision, pas de radio, pas de journaux. Tout était interdit. J’ai lu tout ce que j’ai pu pendant 6 mois et j’ai découvert que la seule évasion possible, c’était la lecture, il n’y avait rien d’autre. J’ai découvert des grands écrivains comme Camus, Giono, Céline… Des géants que j’ai lu ensuite durant toute ma vie. Un jour, j’ai demandé à l’aumônier de la prison un carnet, un stylo, et j’ai commencé moi-même à écrire de petits poèmes, des petits textes.
Quand je lisais, quand j’écrivais, les barreaux s’écartaient et je ne voyais plus la cour de la prison. Je voyais les paysages qui étaient sous mes yeux, ceux de Dostoïevski. Je voyais les routes, les villes… je voyais les femmes. Je suis tombé amoureux d’une femme qui n’existait pas, que j’ai inventé moi-même, et je me suis mis à lui écrire tous les soirs une petite lettre d’amour.
Avez-vous rencontré des prisonniers pour qui la littérature a été aussi importante pour eux que vous vous ?
Évidemment. Même si tous n’ont pas publié, tous ont découvert avec moi la lecture, le plaisir de lire dans sa cellule, d’écrire quelques mots. J’ai travaillé pendant plus de 20 ans aux Baumettes, avec les prisonniers jugés pour des longues peines. C’est là que j’ai connu la plupart des Corses qui étaient en prison à l’époque. Beaucoup étaient encore lié à la Brise de Mer, j’ai connu quelques Ajacciens du Petit Bar. Aussi, des nationalistes et des gens qui passaient du nationalisme au grand banditisme. Pour certains, je leur ai trouvé un éditeur à Paris et ils sont devenus écrivains. Je vois régulièrement des voyous encore en vie, notamment des anciens de la French Connection qui ont été publié.
Vos origines corses reviennent souvent dans vos écrits. Quel est votre rapport à l’île ?
J’ai trois grands-parents sur quatre qui sont Corses. Du côté de ma mère, c’est Orezza, famille Raffalli, et mon grand-père a épousé une Albertini. Mon père, lui, était du Cap Corse, il vivait dans un hameau au-dessus d’Erbalonga. C’était une famille Fregni, qui était arrivée certainement 400 ans plus tôt avec les génois. Les Fregni sont une branche qui ne s’est pas développée et qui était d’origine italo-génoise. Ma quatrième grand-mère était bergère, des Basses-Alpes.
Comme beaucoup de Corses, ils sont venus chercher du travail sur le continent. Mon grand-père maternel est devenu gendarme. Mon grand-père paternel est devenu navigateur. Je suis né à Marseille de parents corses, mais mes parents parlaient de moins en moins le Corse pour nous faire apprendre le français. Nous y allions l’été, retrouver cette vie ancestrale, le jardin, la farine de châtaigne, ma famille restée sur place… J’ai vécu la Corse l’été.
Lorsque j’ai déserté l’armée, et lorsque je me suis évadé de la prison militaire où on m’avait mis pour la deuxième fois, mon réflexe a été de venir me planquer en Corse. Les gendarmes sont allés d’abord fouiller la maison de ma mère à Marseille, puis la maison de mes tantes en Corse. Je suis resté caché à Bastia. C’était beaucoup plus facile pour se planquer et j’ai trouvé très vite du travail dans une boîte de nuit, qui n’existe plus depuis longtemps, U Pozzu sur la place Saint-Nicolas.
J’ai vécu dans une demi-ruine qu’on me prêtait pendant un an et demi au-dessus de Saint Joseph. En Corse, je savais que j’étais et resterai libre. •
Propos recueillis par Léa Ferrandi.
René Frégni, Déserter, entretiens avec Fabrice Lardreau, éditions Arthaud (broché, 2024)