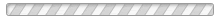Pierre Stambul est porte-parole de l’Union juive française pour la paix. Son père, Yakov Stambul, a fait partie du Groupe Manouchian (l’Affiche Rouge) et est un rescapé du camp de concentration de Buchenwald. Aujourd’hui, Pierre Stambul est un militant engagé aux côtés des palestiniens. À Bastia le 17 avril, il était l’invité du collectif Résistance et Solidarité pour une séance-débat sur le thème : « Génocide à Gaza, que faire ? » Pour Arritti, il développe son engagement pour la cause palestinienne.
Hier soir, vous avez posé le terme « génocide » pour décrire la situation en Palestine. Que mettez-vous derrière ce mot ?
Ce terme, il est très lié à mon histoire personnelle. Ma famille maternelle a, en dehors de ma mère, totalement disparue pendant la Seconde Guerre mondiale. Du côté de mon père, il y a eu énormément de morts aussi. Lui-même a été déporté. La définition du droit international ne comprend pas que l’extermination des populations, mais si on ne parle que de ce point, si on compte les morts et disparus à Gaza, on en est à 45 000. Tous les dirigeants israéliens, toute tendance confondue, ont appelé explicitement à tuer des femmes et des enfants. L’ambassadrice de Palestine en France a par exemple 60 morts dans sa famille.
Le génocide comprend aussi l’organisation de la famine, Quand on a des camions qui sont arrêtés à la frontière et des palestiniens qui sont tués à vue lorsqu’ils cherchent de la nourriture, ça y correspond. Aujourd’hui à Gaza, sur les 45 000 morts, il y a 70 % de femmes et d’enfants. Cela fait partie de la définition internationale de génocide. Si on s’en tient à la définition du droit international sur ce qu’est le génocide, Israël coche toutes les cases.
Face à la situation à Gaza, que faire ?
Il va déjà falloir plus qu’une mobilisation citoyenne. Je tiens à dire, en tant que juif, que nous avons été victimes après la Seconde Guerre mondiale de quelque chose qui s’appelle le négationnisme. Aujourd’hui, le jeu d’un assez grand nombre de médias et d’une grande partie de la classe politique est d’invisibiliser ce que subit le peuple palestinien ce qui, pour nous, est extrêmement grave : mettre en parallèle l’occupant et l’occupé est de mon point de vue anticolonialiste absolument impossible. Là-bas, il y a un occupant qui a chassé le peuple palestinien depuis 57 ans et Gaza qui est enfermée par mer et par terre depuis 17 ans. Nier cette réalité est impossible.
Les palestiniens nous disent deux choses : cette guerre se joue du côté des sociétés palestiniennes, est-ce qu’ils seront assez forts pour ne pas être battus ? C’est là que nous intervenons, à l’UJFP, en solidarité, en construisant des projets comme des maisons des paysans, des infrastructures pour la vie en communauté. Aujourd’hui, nous avons des correspondants qui construisent des camps de réfugiés, sachant que 70 % de l’habitat a été détruit à Gaza. Ça, c’est le premier point : les aider à survivre. Secondement, ce que ce conflit dit, c’est que la complicité de la communauté internationale est très forte. Tous les votes à l’ONU montrent que la majorité des pays sont pour la cause palestinienne. La tendance est menée par une minorité. Il faut donc obliger par des manifestations les gouvernements complices à cesser de l’être et à sanctionner l’occupant. Il n’y aura pas de changement de la part de l’État d’Israël sans sanctions. Ça ne peut arriver que par l’opinion publique. Le boycott aussi est une arme importante : boycott économique, boycott culturel, politique… L’exemple de ce qu’a fait l’Afrique du Sud en portant Israël à la Cour pénale internationale de justice est important contre l’image d’Israël, de traiter ce pays comme un paria. Aujourd’hui, on a l’équivalent de l’OAS au pouvoir. On ne peut les arrêter que par des sanctions, ou il va y avoir encore des milliers de morts.
 Vous avez bien marqué votre engagement antisioniste. Comment définissez-vous cet engagement exactement ?
Vous avez bien marqué votre engagement antisioniste. Comment définissez-vous cet engagement exactement ?
Sur l’antisionisme, nous sommes antisionistes non pas « bien que juifs » mais « parce que juifs ». Nous avons sorti un livre « Antisionisme : une histoire juive » (2023, ed. Syllepse), avec 50 textes de juifs illustres expliquant leur engagement antisioniste. Je vais essayer de définir, d’un point de vue juif, ce qu’est le sionisme : face à l’antisémitisme hégémonique fin XIXe siècle, c’est la pire des réactions. Les sionistes ne combattent pas l’antisémitisme, ils le voient comme inéluctable et la seule solution est la séparation. Les sionistes se sont appuyés sur les pires antisémites, avec un intérêt commun : que les juifs quittent l’Europe. Le sionisme était un nationalisme et le nationalisme du début du XXe siècle signifiait un État ethniquement pur. Le sionisme a inventé une histoire fantastique pour justifier cette grande aventure coloniale, qui a été que, après 2000 ans en exil, on retournerait à une terre promise. Ce qui est faux, car nous autres juifs, sommes la plupart descendants de convertis de différentes périodes et les descendants des judéens de l’antiquité sont majoritairement les palestiniens. Donc, une mystification de l’Histoire. Les religieux juifs étaient majoritairement antisionistes jusque dans les années 1960, parce que la religion juive est messianique, et comme le Messie n’est pas arrivé, il est interdit de retourner sur cette terre. Aujourd’hui, c’est une secte de la religion juive. Pour nous, le sionisme est un crime contre les palestiniens, mais également une injure à notre mémoire et à notre identité. Nous sommes les descendants d’une période où l’émancipation des juifs passaient par l’émancipation de toute l’humanité, notamment après le génocide nazi. « Plus jamais ça » voulait dire plus jamais de racisme, d’exclusion, de suprémacisme. Les sionistes disent « plus jamais ça pour nous »donc qu’il est permis de s’en prendre à l’autre. Le sionisme est totalement suicidaire dans son aspect colonial et identitaire.
Que pensez-vous des solutions telles que la solution à deux États, à un État ?
Concernant la solution à deux États, elle n’est ni possible ni souhaitable. Aujourd’hui, si on exclut Jérusalem, 2,5 millions de palestiniens sont entourés par 600 000 colons. Ce qu’il reste de la Palestine est un confetti, sans unité territoriale. 79 % de la population en Israël n’a rien face à une minorité qui a tout. Les palestiniens ont été fragmentés, entre ceux avec la citoyenneté israëlienne de 1948, ceux de Jérusalem Est, ceux de Gaza, les trois zones de Cisjordanie… Je ne vois pas comment on pourrait donner à une moitié de la population 78 % du territoire et à l’autre moitié 22 %. Surtout que le sionisme est basé sur l’idée de la séparation stricte.
Je ne suis pas non plus pour un seul État : c’était la position historique de l’OLP jusqu’en 1988, un seul État laïc et démocratique. C’était la position d’une grande partie des israéliens jusqu’à récemment, avec une binationalité. C’était une position très souhaitable d’un point de vue idéologique, mais il n’y a plus de forces allant dans ce sens aujourd’hui. Ce que nous prônons, à l’UJFP, c’est l’application du droit international. C’est quelque chose de très simple. Le rôle de la communauté internationale est d’appliquer le droit international dans le futur. Que dit ce droit ? Trois choses : la liberté, ce qui veut dire la fin de l’occupation, de la colonisation, la libération des prisonniers. Ensuite, l’égalité : tous les hommes sont libres et égaux, donc aucune discrimination entre habitants. Enfin, la justice : le crime fondateur de cette guerre a été l’expulsion des palestiniens de ce pays, donc c’est le retour des réfugiés. Il faut également y rajouter le jugement des criminels de guerre. La communauté internationale joue sa peau sur cette affaire : soit on applique ce droit en disant que c’est sur cette base que les conflits et guerres doivent être réglés, ou on arrête son application, et c’est la loi de la jungle. Donc, sur la question palestinienne, imposer le droit international comme cadre, c’est fondamental. Ensuite, nous pourrons voir la forme que ça prend : ce n’est pas obligatoirement un seul État, pas forcément centralisé ou laïc : une confédération, une fédération… Tout est possible, à condition que la base soit le droit international. •