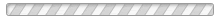par François Alfonsi
Les évènements violents tels qu’ils se succèdent à un rythme soutenu n’étaient pas prévisibles dans le détail, mais ils ne sont in fine que le résultat de choix politiques de long terme. Le choix de mépriser les élus nationalistes corses cinq années durant par les gouvernements successifs d’Emmanuel Macron a créé les conditions de la violence qui a envahi les rues d’Aiacciu ce dimanche, après celles de Corti et Bastia.
Premier choix assumé : fermer la porte à tout rapprochement pour les prisonniers politiques et même afficher ouvertement, comme l’a fait Edouard Philippe quand il était Premier ministre, que les « assassins du Préfet » ne sortiraient de prison qu’une fois à l’article de la mort. De cette attitude inique, contraire au droit et à la condamnation qu’ils purgeaient, puisqu’ils ils étaient éligibles de façon légale à un rapprochement en Corse, puis à une libération conditionnelle à partir de vingt années passées derrière les barreaux, a découlé le drame survenu dans la prison d’Arles qui a coûté la vie à Yvan Colonna.
L’enquête sur les conditions de cette agression sauvage par un détenu djihadiste hyper-violent, au vu et au su des caméras de surveillance qui quadrillent la prison de haute sécurité, ne donne aucun éclaircissement convaincant sur les conditions dans lesquelles cette agression a été rendue possible. Et il est une certitude : jamais elle n’aurait eu lieu si Yvan Colonna avait été rapproché dans la prison corse de Borgu. De ce choix politique d’Emmanuel Macron et de ses gouvernements découle mécaniquement la responsabilité de l’État dénoncée par la banderole de tête des différents cortèges, « Statu Francesu Assassinu ».
Deuxième choix assumé : traiter les élus de la Corse, et donc les électeurs qui leur ont apporté leurs suffrages, par le mépris. Ce mépris a été manifeste dès le 6 février 2018, six mois après l’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République française, et un mois après la réélection de Gilles Simeoni à la tête de la Collectivité de Corse par une majorité absolue des électeurs corses.
Ce jour-là, Emmanuel Macron est venu en Corse flanqué de Jean Pierre Chevènement et de plusieurs figures anti-nationalistes, dont Emile Zuccarelli pourtant défait par les urnes bastiaises. La date choisie, à savoir le jour de la commémoration de l’assassinat du préfet Erignac, a été le moyen choisi pour porter un message fermé, et pour donner des signes multiples en vue de déconsidérer les nouveaux élus de la Corse, catalogués comme « élus locaux », relégués loin derrière l’administration préfectorale dans l’ordre protocolaire des rencontres, fouillés au corps par le service d’ordre présidentiel comme de simples trublions, comme le seront les « gilets jaunes » après eux.
Puis s’en sont suivis cinq années de déconvenues successives, de discours fermant toutes les portes à une évolution vers l’autonomie, jusqu’à la remise en cause des avancées obtenues avec François Hollande pendant les 18 premiers mois de présidence nationaliste de l’Assemblée de Corse, notamment sur le financement du Comité de Massif via les surplus de la continuité territoriale, ou par une recentralisation préfectorale de l’attribution des programmes du Plan Exceptionnel d’Investissement de Lionel Jospin, devenu PTIC sous Edouard Philippe, et enfin par la nomination de préfets au profil marqué, Josiane Chevalier et surtout Pascal Lelarge, dont la feuille de route était manifestement de contrer le président du Conseil exécutif et de favoriser son opposition. Cela s’est conclu par une déroute électorale, Gilles Simeoni ayant reçu plus de suffrages que jamais lors des élections territoriales de juin 2021.
Le sens démocratique le plus élémentaire aurait consisté à prendre alors acte de la nouvelle donne politique de la Corse, et d’ouvrir aussitôt l’espace de dialogue institutionnel qui s’imposait. Au lieu de cela, huit mois durant, l’État a maintenu à son poste un préfet nocif et virulent, démontrant ainsi son refus de changer de politique.
Cette accumulation de tensions a été suivie d’une déflagration majeure du fait de l’agression d’Yvan Colonna à la prison d’Arles. Gérald Darmanin a aussitôt été dépêché en Corse pour ouvrir, sous la pression de la rue, le dialogue qui aurait dû être ouvert depuis bien longtemps par la simple prise en compte des réalités démocratiques de la Corse.
Il peut désormais essayer de jouer avec les excès inévitables des mobilisations d’une jeunesse que l’on a poussé à bout cinq années durant. C’est ce que Gérald Darmanin a fait en reportant le lancement du cycle des réunions promises en vue d’avancées institutionnelles, « jusqu’à l’autonomie ».
Mais l’État a lui-même attisé la colère de la rue qu’il dénonce aujourd’hui. Il faudra dès lors plus que des postures médiocres, manifestement électoralistes, pour apporter enfin, après cinquante ans, une solution à la question corse, solution qui devra être politique et de portée historique. •