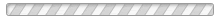Les sommets des chefs d’États de l’Union Européenne sont des marathons entre négociateurs qui épuisent observateurs et journalistes. Face à la crise économique en cours, et à l’urgence des solutions à y apporter, la règle de l’unanimité pour les décisions à prendre y révèle sa perversité profonde.
L’unanimité du « tous d’accord » est en réalité un faux nez. Il s’agit en fait du contraire, du droit de véto que chaque État-membre se réserve comme arme ultime pour imposer son désaccord à la totalité des autres.
En fait, tous ces chefs d’États, obligés de subir le suspense jusqu’au bout, se trouvent pris à leur propre piège. Pris séparément, pas un seul ne veut renoncer à ce droit de véto pour lui-même. Mais ils vilipendent avec vigueur, le jour venu, celui d’entre eux qui en fait usage alors que tous les autres sont prêts à ratifier un accord.
Aussi chaque sommet des Chefs d’État de l’Union Européenne est un psychodrame écrit à l’avance, fait de séances interminables et de conciliabules scénarisés qui se déroulent devant et hors les caméras.
L’enjeu principal est pour chacun d’apparaître aux yeux de sa propre opinion publique celui qui utilise son droit de veto national avec le plus de détermination. L’accord final variera peu des premières propositions élaborées par la Commission et défendues par le Président du Conseil Européen, et, dans une négociation aussi importante, l’option « pas d’accord » n’est pas envisageable. Reste l’option de faire monter les enchères pour se faire mousser dans le sens des attentes de sa propre opinion publique.
Quels sont les termes de la négociation, et sur quoi bute-t-elle ?
Premier terme, celui du montant global mis sur la table. Le Parlement a proposé 1.000 milliards d’euros, France et Allemagne, les principaux contributeurs, ont annoncé 750 milliards, pour deux tiers en subventions et un tiers en prêts, niveau auquel se sont ralliés la Commission et les pays bénéficiaires (principalement Italie, Espagne, Portugal, Croatie et Grèce). Au final, après quatre jours et quatre nuits, ce sera bien 750 milliards répartis entre subventions (55 %) et prêts (45 %). Fallait-il vraiment tant de temps pour arriver à ce point d’équilibre probablement écrit à l’avance ?
Deuxième terme, la conditionnalité, c’est à dire les exigences des donateurs pour que l’aide accordée s’accompagne de concessions sur la question des « valeurs », là où l’État de droit est menacé par des gouvernements autoritaires. Principaux visés, la Hongrie et la Pologne, qui attendent pourtant ces fonds européens avec impatience, ont menacé de tout bloquer. Au final, cette conditionnalité sera bien là, mais liée à une majorité qualifiée de 55 %, telle que définie par le traité de Lisbonne, majorité à laquelle ils ne pourront seuls s’opposer. La concession est donc bien symbolique, mais elle permet à Orban de parader en Hongrie en affirmant avoir « fait céder Bruxelles ».
L’autre conditionnalité, celle d’un « droit de regard » sur les finances des pays bénéficiaires, était sans objet car un tel mécanisme, appelé le « semestre européen » dans le jargon bruxellois, existe déjà qui soumet à l’analyse sourcilleuse de l’Union Européenne les budgets annuels des États-membres, afin d’éviter tout « déficit excessif ». Mais son obstination largement médiatisée a permis à Mark Rutte de donner des gages à une opinion hollandaise persuadée d’être la vache à lait des pays du sud, alors même que son pays, par son système fiscal dérogatoire, et par la position dominante du port de Rotterdam qui lui permet d’encaisser une partie des droits de douane sur les marchandises importées par tous les pays d’Europe, bénéficie outrageusement du marché unique européen. Et, en passant il a pu rafler quelques milliards d’un « rabais » sur sa contribution au budget de l’Union, selon la tradition radine instaurée par Margaret Thatcher.
Ces sommets européens ne sont au final qu’un exercice de communication. Aux Pays Bas, le premier ministre hollandais Mark Rutte pourra expliquer à ses parlementaires eurosceptiques qu’il a été intransigeant ; en Hongrie, le premier ministre Viktor Orban paradera en affirmant « avoir fait céder Bruxelles » ; en France Emmanuel Macron s’affichera en « sauveur de l’Europe » ; et en Espagne ou en Italie on expliquera avoir fait primer « l’indépendance nationale ». Quant à l’Allemagne d’Angela Merkel, elle fera profil bas, tout en diffusant discrètement l’image de sa puissance déterminante sur le continent européen.
Tous ces faux semblants sont autant de signes inquiétants de la crise politique actuelle de l’Union Européenne, alors même que la crise économique en cours appelait une gouvernance commune efficace et rapide. Le Plan de Relance est finalement adopté. Il est vital pour l’avenir, au final assez ambitieux en termes financiers, et surtout très novateur puisqu’il ouvre la voie à un emprunt mutualisé entre les 27, ce qui est un précédent qui marquera l’Histoire de la construction européenne qui s’y était toujours refusée jusque là.
Mais devra-t-on subir encore longtemps ces gesticulations qui mettent en scène l’orgueil des Etats et qui font que les sommets européens où se prennent les décisions les plus importantes donnent l’image d’un sommet de paralytiques incapables d’avancer ensemble ? Il est plus que temps de rompre avec ces mascarades.